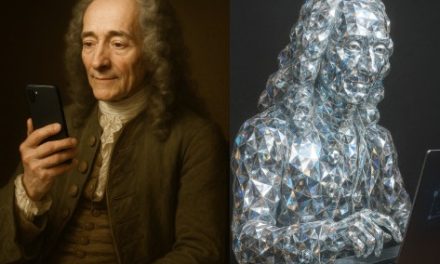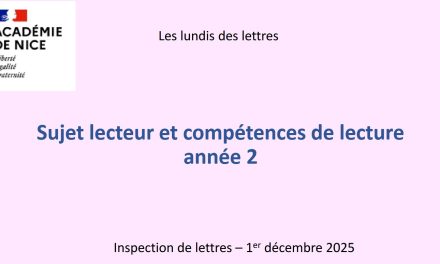Lire une œuvre numérique intégrale en classe : et si l’on redonnait la parole aux lecteurs ?
Nous le savons en tant que professionnels de l’enseignement des lettres : les adolescents passent aujourd’hui beaucoup plus de temps devant leurs écrans que dans les livres (CNL-IPSOS, 2024). Mais cela ne signifie pas pour autant qu’ils ne lisent plus. Leurs pratiques évoluent : mangas, romans sur smartphone, audiobooks… autant de formes de lecture bien éloignées des habitudes scolaires, qui sont encore très attachées au papier et au modèle traditionnel de l’explication de texte (Brunel et al., 2024 ; Ahr & de Peretti, 2023).
Face à cette évolution, une question s’impose : comment faire dialoguer les pratiques culturelles des élèves et les pratiques scolaires de la lecture littéraire ?
Et si les œuvres littéraires numériques, par leur multimodalité et leur interactivité (Saemmer & Tréhondart, 2014 ; Bouchardon, 2014), pouvaient offrir une passerelle entre ces deux univers ? Plusieurs recherches (Brunel & Bouchardon, 2020 ; Lacelle & Lebrun, 2012) montrent en effet qu’elles favorisent l’immersion et la réception subjective – deux dimensions essentielles pour donner toute sa place au lecteur en classe.
C’est dans cette perspective qu’a été menée une expérimentation autour d’une bande défilée numérique qui mêle récit, graphisme et univers sonore.
Découvrez la bande-annonce de Phallaina pour plonger dans son univers immersif : https://www.youtube.com/watch?v=GIqQIpmhJGQ
Phallaina de Marietta Ren : Une expérimentation collective, du collège au lycée
Le projet a réuni six enseignants de lettres : quatre en collège (classes de 5e) et deux en lycée (classes de seconde). Une diversité de niveaux qui a permis d’observer comment les élèves de différents âges et profils s’approprient une œuvre numérique.
Tous les enseignants ont mené la lecture intégrale de Phallaina une bande défilée (roman graphique numérique) de 2016, écrite par Marietta Ren, où texte, image et son se conjuguent. L’expérimentation s’appuyait sur un dispositif de cercles de lecture, didactiques et réflexifs (Brunel, Acerra & Lacelle, 2022), mêlant échanges personnels et réflexion professionnelle.
Des pratiques diversifiées, un même objectif : impliquer le lecteur
Malgré des contextes variés, les différentes séquences observées ont accordé une place centrale au sujet lecteur (Rouxel & Langlade, 2004 ; Vibert, 2012).
Les enseignants ont expérimenté plusieurs modalités :
- 🎧 Entrer par le son : écoute de l’incipit sonore avant toute image ou texte, afin de susciter des hypothèses à partir de l’ambiance et une visualisation mentale du récit.Résultat : une pluie d’images mentales et d’attentes de lecture.
- ✍️ Carnets de lecture : libres et créatifs, ils pouvaient prendre la forme de dessins, de réflexions ou d’un journal intime du personnage. Certains extraits ont été lus à haute voix et accueillis par des applaudissements enthousiastes.
- 💬 Débats interprétatifs : autour de l’identité d’Audrey, l’héroïne, ou de la fin ouverte du récit.
- 🔗 Création de réseaux culturels avec des comparaisons spontanées avec La petite Sirène d’Andersen, Ponyo sur la Falaise de Miyazaki ou Vaiana des studios Disney.
- 👥 Relectures collectives ouvertes : la lecture à voix haute, accompagnée des réactions en direct des élèves, a transformé la classe en véritable communauté interprétative.
Des effets observables : engagement, plaisir de lire et postures renouvelées
Les observations convergent : la lecture de Phallaina a provoqué une implication forte des élèves, y compris de ceux qui se montrent habituellement en retrait face aux textes littéraires.
La multimodalité de l’œuvre a facilité l’immersion sensorielle immédiate (Saemmer, 2015) des élèves. Les sons, les images et le mouvement du texte ont permis aux lecteurs fragiles d’accéder au sens autrement et ont rendu plus visibles les émotions partagées par le groupe classe.
Pour les enseignants, ces séquences ont été l’occasion de sortir de leurs habitudes. Les dispositifs traditionnels (lecture linéaire, explication de texte) ont laissé place à des approches plus sensibles, réflexives et interactives. Plusieurs pratiques (lectures immersives, carnets de réception, discussions libres) étaient inédites pour eux, confirmant l’idée que les œuvres numériques peuvent élargir le champ des possibles pour enseignement de la lecture littéraire. (Brunel et al., 2022 ; Florey, Jeanneret & Mitrovic, 2020).
Bilan et perspectives
L’expérimentation autour de Phallaina menée dans le carde du GND montre qu’une œuvre numérique intégrale peut devenir un levier pour :
- Rapprocher pratiques scolaires et pratiques culturelles des élèves,
- Donner plus de place aux émotions, sensations et interprétations,
- Encourager les enseignants de lettres à tenter des dispositifs nouveaux et à renouveler leurs gestes professionnels.
- Et, surtout, redécouvrir le plaisir de lire en communauté en impliquant tous les profils d’élèves.
Ces résultats invitent à poursuivre l’exploration des œuvres numériques dans l’enseignement des lettres, afin que la classe fasse dialoguer culture numérique et culture littéraire, sensibilité et analyse, individualité et collaboration.
Rédaction : Ugo Besson-Planeilles, professeur au collège H. Nans (Aups)
Collaboration : Nathalie Perez, professeure au lycée Beaussier (La Seyne-sur-Mer)
Cadre : Groupe Numérique Disciplinaire (GND) Lettres – Académie de Nice, sous la responsabilité de l’IA-IPR de lettres, Sébastien Hébert.
Cet article s’appuie sur les expérimentations menées collectivement par six enseignants de collège et de lycée autour de la lecture numérique de Phallaina de Marietta Ren et a bénéficié de l’accompagnement scientifique de Magali Brunel, enseignante-chercheuse en didactique des lettres.
Pour découvrir un scénario détaillé de mise en œuvre en classe de seconde, consultez également :
Lire et interpréter une œuvre numérique : Phallaina, un récit multimodal et immersif pour explorer la lecture autrement – mars 2025
(par Nathalie Perez, lycée Beaussier)