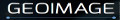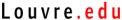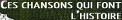Un point de passage et d’ouverture en Première :
Louise Michel et la Commune de Paris
 Le point de passage et d’ouverture sur « Louise Michel et la Commune de Paris » est probablement l’un des plus riches en sources facilement accessibles pour faire travailler les élèves. Louise Michel a elle-même écrit une trentaine de livres.
Le point de passage et d’ouverture sur « Louise Michel et la Commune de Paris » est probablement l’un des plus riches en sources facilement accessibles pour faire travailler les élèves. Louise Michel a elle-même écrit une trentaine de livres.
Le présent document recense les différentes possibilités pour le professeur et les différents documents utilisables en classe (ouvrages historiques, romans, poèmes, bandes dessinées, témoignages).
 Ce Point de passage et d’ouverture permet de travailler avec les élèves plusieurs points importants :
Ce Point de passage et d’ouverture permet de travailler avec les élèves plusieurs points importants :
- la notion d’évènement en histoire. Michel Winock définit un évènement par quatre critères fondamentaux : son imprévisibilité, son retentissement, son intensité et sa portée historique. La Commune est de ce point de vue un cas d’école. Aujourd’hui encore, les débats sont vifs sur l’interprétation de ce moment historique.
- la place des femmes dans l’histoire de France. Champs de travail historique en plein développement, l’histoire des femmes continue sa progression dans les programmes scolaires. Louise Michel est une personnalité intellectuelle et politique particulièrement intéressante. C’est le 26ème personnage le plus cité dans les lieux publics (une station de métro, un square, 190 établissements scolaires), ce qui montre sa place dans l’imaginaire collectif.
- l’engagement intellectuel et politique. Louise Michel permet d’aborder la notion de mouvement politique : elle est en contact avec les principaux leaders du mouvement, mais aussi avec les intellectuels de son temps. Ainsi, Victor Hugo prend la défense de Louise Michel lors de son procès par un magnifique poème qui témoigne des liens d’amitiés qui se sont constitués au fils de leur correspondance.
 Il s’agit donc d’un point de passage et d’ouverture qui devrait susciter l’intérêt des élèves et constitue une entrée passionnante dans les problématiques de la IIIème République.
Il s’agit donc d’un point de passage et d’ouverture qui devrait susciter l’intérêt des élèves et constitue une entrée passionnante dans les problématiques de la IIIème République.
Virginie Matheron-Ruel, Formatrice Histoire Géographie Académie de Nice
Mars 2019
Un point de passage et d’ouverture en Première :
Paris haussmannien
 Les PPO sont tous obligatoires, traitant de dates, lieux et acteurs, mais leur traitement est variable tant dans la durée à lui accorder que dans la forme qu’il peut prendre, selon le projet pédagogique du professeur.
Les PPO sont tous obligatoires, traitant de dates, lieux et acteurs, mais leur traitement est variable tant dans la durée à lui accorder que dans la forme qu’il peut prendre, selon le projet pédagogique du professeur.
 Il faudra veiller à la cohérence que présentent les différents PPO des chapitres 2 des thèmes 2 et 3 du programme (risque de redondance).
Il faudra veiller à la cohérence que présentent les différents PPO des chapitres 2 des thèmes 2 et 3 du programme (risque de redondance).
 Ici, il s’agit de proposer trois possibilités de mise en oeuvre des PPO :
Ici, il s’agit de proposer trois possibilités de mise en oeuvre des PPO :
- Un document d’accroche dans la séquence 2 du thème 2 « l’industrialisation et l’accélération des transformations économiques et sociales en France ». Le temps consacré est court, et donne lieu à une écoute active de la part des élèves qui légendent le document avec une description précise (ici seules les différentes rubriques sont indiquées). Une oeuvre d’art, toujours représentative de son époque, les peintres impressionnistes ont été les premiers peintres de la ville, est de plus un support aisé à utiliser pour les élèves (d’autres oeuvres sont proposées à la fin du diaporama).
- La deuxième proposition, qui nécessite un temps plus long, est l’étude d’un large corpus documentaire. Ce PPO est particulièrement commode à documenter. Cela permet un travail de groupe. Chaque groupe ayant un corpus différent afin de ne traiter qu’un sous-thème à la fois, c’est le travail de l’ensemble de la classe (travail en puzzle) qui permettra d’aboutir lors de la restitution à la trace écrite complète (par exemple sous forme de schéma sagittal). Selon la composition des groupes, le questionnement peut être différencié afin de s’adapter aux besoins des élèves.
Le PPO Paris haussmannien permet d’aborder directement deux des objectifs du chapitre, « la modernisation encouragée par le Second Empire » et l’importance politique de la question sociale ». En insistant par exemple sur le fait que l’empereur Napoléon III était un adepte du saint-simonisme et de « l’extinction du paupérisme ». Pour les autres objectifs, « les transformations des modes de production » apparaissent avec les nouveaux matériaux de l’époque (briques cuites au coke, métallurgie…), « les débuts de l’exode rural » se lisent dans la croissance démographique de la capitale.
- Enfin la troisième proposition s’appuie sur un ou deux documents en conclusion de la séquence (par exemple Paris avant/Paris après). Ces documents peuvent être traités comme le document d’accroche, avec une légende détaillée.
 D’autres options sont bien sûr envisageables, comme de donner des documents en amont du cours, ou des sujets d’exposés.
D’autres options sont bien sûr envisageables, comme de donner des documents en amont du cours, ou des sujets d’exposés.
Hélène Jullien, Formatrice Histoire Géographie Académie de Nice
Mars 2019
Thème 3 en Géographie Seconde
Des mobilités généralisées
 Le thème 3 du programme de géographie de la classe de seconde, intitulé « Des mobilités généralisées » (12-14 heures), s’inscrit dans une analyse plus globale, centrée sur la notion de transition. Celle-ci, au coeur du programme de la classe de seconde, est analysée par les mutations démographiques, économiques, technologiques et environnementales que le monde connaît et par ses manifestations territoriales. Ce programme implique à juste titre une vision dynamique - repérer les processus en cours et les discontinuités spatiales - et une approche de la complexité par une analyse en échelles interconnectées et une approche systémique des espaces et des acteurs.
Le thème 3 du programme de géographie de la classe de seconde, intitulé « Des mobilités généralisées » (12-14 heures), s’inscrit dans une analyse plus globale, centrée sur la notion de transition. Celle-ci, au coeur du programme de la classe de seconde, est analysée par les mutations démographiques, économiques, technologiques et environnementales que le monde connaît et par ses manifestations territoriales. Ce programme implique à juste titre une vision dynamique - repérer les processus en cours et les discontinuités spatiales - et une approche de la complexité par une analyse en échelles interconnectées et une approche systémique des espaces et des acteurs.
 Comme dans l’ensemble des programmes, la réflexion géographique permet l’étude des enjeux et des relations entre les acteurs, une approche multiscalaire et la différenciation d’un même phénomène en fonction de l’échelle choisie, la comparaison entre les territoires pour identifier les ressemblances et les spécificités de chacun, l’analyse critique des documents et réalisation de croquis.
Comme dans l’ensemble des programmes, la réflexion géographique permet l’étude des enjeux et des relations entre les acteurs, une approche multiscalaire et la différenciation d’un même phénomène en fonction de l’échelle choisie, la comparaison entre les territoires pour identifier les ressemblances et les spécificités de chacun, l’analyse critique des documents et réalisation de croquis.
 Le thème 3 est structuré, comme l’ensemble du programme, par deux questions, l’une à l’échelle mondiale – les migrations internationales et les mobilités touristiques internationales – et l’autre, à l’échelle de la France (mobilités, transports et enjeux d’aménagement).
Le thème 3 est structuré, comme l’ensemble du programme, par deux questions, l’une à l’échelle mondiale – les migrations internationales et les mobilités touristiques internationales – et l’autre, à l’échelle de la France (mobilités, transports et enjeux d’aménagement).
 L’analyse à l’échelle nationale doit être réalisée à part entière, le programme laissant une liberté d’ordre de l’analyse (du monde vers la France ou l’inverse) ; toute la difficulté résidant en l’articulation entre les deux échelles.
L’analyse à l’échelle nationale doit être réalisée à part entière, le programme laissant une liberté d’ordre de l’analyse (du monde vers la France ou l’inverse) ; toute la difficulté résidant en l’articulation entre les deux échelles.
 Une étude de cas est recommandée sans être pour autant obligatoire. Dans cette présentation, le choix se porte sur l’étude de Dubaï en tant que pôle touristique et migratoire.
Une étude de cas est recommandée sans être pour autant obligatoire. Dans cette présentation, le choix se porte sur l’étude de Dubaï en tant que pôle touristique et migratoire.
 Par ailleurs, chacun des trois thèmes « nourrit » le thème conclusif « qui applique l’ensemble des savoirs et compétences acquis par l’étude des trois premiers thèmes à l’étude d’une aire géographique (pays, ensemble de pays).» Dans le cas présent, il s’agit de l’Afrique australe, étudiée sous le prisme d’un espace en profonde mutation.
Par ailleurs, chacun des trois thèmes « nourrit » le thème conclusif « qui applique l’ensemble des savoirs et compétences acquis par l’étude des trois premiers thèmes à l’étude d’une aire géographique (pays, ensemble de pays).» Dans le cas présent, il s’agit de l’Afrique australe, étudiée sous le prisme d’un espace en profonde mutation.
 En se référant aux définitions de la notion de mobilité par un certain nombre de géographes dont Jacques Lévy - « ensemble des manifestations liées au mouvement des réalités sociales (hommes, objets matériels et immatériels) dans l’espace. » - ou Magali Reghezza-Zitt - « La mobilité désigne tout mouvement qui permet à un individu (ou un groupe) de changer de lieu : ce terme recouvre à la fois le déplacement avéré et un potentiel de mouvement. Il excède très largement la notion de flux. La mobilité suppose non seulement d’intéresser au mode de transport, mais aussi aux motivations, aux usages, aux parcours des individus mobiles. » - nous pouvons problématiser le thème de la manière suivante :
En se référant aux définitions de la notion de mobilité par un certain nombre de géographes dont Jacques Lévy - « ensemble des manifestations liées au mouvement des réalités sociales (hommes, objets matériels et immatériels) dans l’espace. » - ou Magali Reghezza-Zitt - « La mobilité désigne tout mouvement qui permet à un individu (ou un groupe) de changer de lieu : ce terme recouvre à la fois le déplacement avéré et un potentiel de mouvement. Il excède très largement la notion de flux. La mobilité suppose non seulement d’intéresser au mode de transport, mais aussi aux motivations, aux usages, aux parcours des individus mobiles. » - nous pouvons problématiser le thème de la manière suivante :
• Dans quelle mesure les mobilités humaines transforment-elles en profondeur l’organisation des territoires, tant à l’échelle locale que nationale ou mondiale ?
• Dans quelle mesure les mobilités humaines sont-elles facilitées par la mise en place de réseaux de communication variés, hiérarchisés et organisés par des acteurs ?
• Quels sont les enjeux créés par les mobilités en termes d’aménagement des territoires, d’intégration dans la mondialisation et de transition environnementale ?
 A cette fin, Dubaï est une excellente étude de cas, ville connue, au moins de nom, par les élèves, qui montre un territoire transformé par les mobilités internationales tant touristiques que migratoires liées à l’obtention d’un travail dans des conditions bien souvent éloignées du mirage vanté par les publicités.
A cette fin, Dubaï est une excellente étude de cas, ville connue, au moins de nom, par les élèves, qui montre un territoire transformé par les mobilités internationales tant touristiques que migratoires liées à l’obtention d’un travail dans des conditions bien souvent éloignées du mirage vanté par les publicités.
 Mais par-delà cet exemple territorial, il s’agit de bien faire comprendre que la mobilité est constitutive de l’espèce humaine : l’Homme est un être bipède qui s’est largement motorisé depuis la fin du XIXème siècle pour se déplacer sur terre, sur les mers et dans les airs. Comme le rappelle Jacques Lévy, « la mobilité est constitutive du monde mondialisé » et le processus le plus flagrant est le véritable découplage entre la distance géographique et la distance temporelle : on a une multiplicité des distances temporelles associées à une même distance géographique. En conséquence, la mobilité fabrique des organisations réticulaires et des territoires inédits où l’accès à la pluralité des mobilités est inégal, accentuant les inégalités territoriales, phénomène visible aux échelles mondiale, continentale (l’Afrique) comme nationale (la France).
Mais par-delà cet exemple territorial, il s’agit de bien faire comprendre que la mobilité est constitutive de l’espèce humaine : l’Homme est un être bipède qui s’est largement motorisé depuis la fin du XIXème siècle pour se déplacer sur terre, sur les mers et dans les airs. Comme le rappelle Jacques Lévy, « la mobilité est constitutive du monde mondialisé » et le processus le plus flagrant est le véritable découplage entre la distance géographique et la distance temporelle : on a une multiplicité des distances temporelles associées à une même distance géographique. En conséquence, la mobilité fabrique des organisations réticulaires et des territoires inédits où l’accès à la pluralité des mobilités est inégal, accentuant les inégalités territoriales, phénomène visible aux échelles mondiale, continentale (l’Afrique) comme nationale (la France).
Thierry Sitter-Thibaulot, formateur Histoire et Géographie Académie de Nice
juin 2019
Thème 3 de la spécialité Histoire Géographie Géopolitique Science Politique
Étudier les divisions politiques du monde : les frontières
 Chaque thème articule les 4 champs disciplinaires : Histoire, Géographie, Géopolitique et Science politique.
Chaque thème articule les 4 champs disciplinaires : Histoire, Géographie, Géopolitique et Science politique. Chaque thème est toujours conçu de la même façon :
Chaque thème est toujours conçu de la même façon :
- Une articulation des temporalités : le passé plus ou moins lointain éclaire le présent et l’actualité,
- Une articulation des espaces afin de croiser les échelles.
 Il met l’accent sur les comparaisons et les acteurs toujours au centre des 4 disciplines.
Il met l’accent sur les comparaisons et les acteurs toujours au centre des 4 disciplines. Les quelques lignes du BO qui suivent l’intitulé du thème sont très explicites et fixent les objectifs à atteindre. Ici « faire comprendre aux élèves ce que sont les frontières politiques : leurs formes, leurs dynamiques, les enjeux internes et externes qui leur sont associés. Les élèves doivent percevoir que les frontières sont des zones de séparation et de contact, qu’elles sont ouvertes ou fermées, matérialisées ou non ».
Les quelques lignes du BO qui suivent l’intitulé du thème sont très explicites et fixent les objectifs à atteindre. Ici « faire comprendre aux élèves ce que sont les frontières politiques : leurs formes, leurs dynamiques, les enjeux internes et externes qui leur sont associés. Les élèves doivent percevoir que les frontières sont des zones de séparation et de contact, qu’elles sont ouvertes ou fermées, matérialisées ou non ».
 Le diaporama présente quelques pistes :
Le diaporama présente quelques pistes :
- Pour réaliser l’introduction du thème 3 en posant ses enjeux.
L’important est de partir de l’actualité, toujours riche sur les sujets proposés par le programme. Pour susciter la curiosité et l’intérêt des élèves, il importe de varier les supports : presse, BD, art, photos, cartes, etc.
On peut proposer par exemple des chroniques frontalières aux élèves, propices à un travail cartographique de localisation, de typologie des problématiques liées aux frontières mettant en scène des acteurs variés. On peut imaginer aussi faire construire cette chronique tout au long de l’année, en faisant travailler les élèves sur l’actualité chaque semaine.
- Pour choisir des exemples.
A côté des Jalons obligatoirement traités, il faut aussi choisir des exemples afin de traiter les axes avec le plus de richesse possible.
Quelques propositions et documents sont proposés pour cela (Irlande, Chypre pour l’objet conclusif).
 L’enseignement de spécialité doit permettre d’approfondir les connaissances des élèves et leurs capacités d’analyse, de travail en autonomie, d’expression écrite et orale bien sûr en fonction de l’épreuve du grand oral de Terminale. Les débats et les controverses sont recommandés.
L’enseignement de spécialité doit permettre d’approfondir les connaissances des élèves et leurs capacités d’analyse, de travail en autonomie, d’expression écrite et orale bien sûr en fonction de l’épreuve du grand oral de Terminale. Les débats et les controverses sont recommandés.
Hélène Jullien, formatrice histoire géographie Académie de Nice
Mars 2019
 Des mobilités généralisées - M. Sitter-Thibaulot
Des mobilités généralisées - M. Sitter-Thibaulot
 L'Afrique australe - Mme Balocchi, M. Orcier
L'Afrique australe - Mme Balocchi, M. Orcier
 Les inondations de 2015 dans les Alpes-maritimes - Mmes Beriou, Luciani
Les inondations de 2015 dans les Alpes-maritimes - Mmes Beriou, Luciani
![]() Première
Première
 Les espaces ruraux - Mme Balocchi
Les espaces ruraux - Mme Balocchi 
 La métropolisation - M. Lagaude
La métropolisation - M. Lagaude 
 Nations, empires, nationalités - PPO - Le rattachement de Nice et de la Savoie à la France - M. Revert
Nations, empires, nationalités - PPO - Le rattachement de Nice et de la Savoie à la France - M. Revert
 Nations, empires, nationalités - La proclamation de l'Empire allemand de Von Werner - Mme Le Guen-Virilli
Nations, empires, nationalités - La proclamation de l'Empire allemand de Von Werner - Mme Le Guen-Virilli
 La Révolution française : une nouvelle conception de la nation - Mme Le Guen-Virilli
La Révolution française : une nouvelle conception de la nation - Mme Le Guen-Virilli
 1ère Guerre mondiale : l’échec de la guerre de mouvement - M. Faget
1ère Guerre mondiale : l’échec de la guerre de mouvement - M. Faget
 1ère Guerre mondiale : les offensives alliées victorieuses de 1918 - M. Faget
1ère Guerre mondiale : les offensives alliées victorieuses de 1918 - M. Faget
 Sortir de la guerre : la tentative de construction d’un ordre des nations démocratiques - Mme Louis
Sortir de la guerre : la tentative de construction d’un ordre des nations démocratiques - Mme Louis
 Point de passage et d'ouverture : Paris haussmannien - Mme Jullien
Point de passage et d'ouverture : Paris haussmannien - Mme Jullien
 Point de passage et d'ouverture : Louise Michel - Mme Matheron-Ruel
Point de passage et d'ouverture : Louise Michel - Mme Matheron-Ruel
 Points de passage et d'ouverture : Femmes dans l’Histoire et Histoire des femmes - M. Lamotte
Points de passage et d'ouverture : Femmes dans l’Histoire et Histoire des femmes - M. Lamotte
 Jalon : Une puissance qui se reconstruit après l'éclatement d'un empire :
Jalon : Une puissance qui se reconstruit après l'éclatement d'un empire :
0000000.La Russie depuis 1991 - M. Sitter-Thibaulot
 Jalon : Les nouvelles routes de la soie - Mme Jahier
Jalon : Les nouvelles routes de la soie - Mme Jahier
 Les frontières - Mme Jullien
Les frontières - Mme Jullien
 Les frontières - M. Ruiz
Les frontières - M. Ruiz
 Jalon : Redécouper les frontières : une solution pour la paix au Moyen Orient ? - M. Descombaz
Jalon : Redécouper les frontières : une solution pour la paix au Moyen Orient ? - M. Descombaz
 Jalon : Les frontières d'un Etat de l'UE : la Lettonie - M. Orcier
Jalon : Les frontières d'un Etat de l'UE : la Lettonie - M. Orcier
 Jalon : La frontière entre les deux Corées - Mme Jahier
Jalon : La frontière entre les deux Corées - Mme Jahier
 Jalon : La laïcité en Turquie : Mustafa Kémal - Mme Le Guen-Virilli
Jalon : La laïcité en Turquie : Mustafa Kémal - Mme Le Guen-Virilli
![]() Première technologique
Première technologique
 La bataille de Waterloo - M. Faget
La bataille de Waterloo - M. Faget
Page 9 sur 13